Les récentes décisions politiques du gouvernement Trump, de l’introduction des droits de douane mondiaux les plus élevés depuis un siècle au démantèlement des réglementations climatiques, transforment les cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Alors que les marchés internationaux absorbent les répercussions du « Liberation Day », instaurant des droits de douane d’au moins 10% sur les importations américaines et des droits significativement plus importants sur une soixantaine de pays, un nouveau bras de fer aux enjeux cruciaux se profile : le retrait des Etats-Unis de l’action climatique. Trump 2.0 est déterminé à démanteler les réglementations environnementales clés, ce qui suscite des inquiétudes quant au rôle du pays dans la lutte contre le changement climatique. Où en est-on ?
1) Retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris (une fois de plus)
2) Assouplissement des réglementations environnementales
3) Promotion de l’extraction de combustibles fossiles
4) Allègement des mesures incitatives visant à favoriser les énergies renouvelables
Mi-mars, Lee Zeldin, nouveau directeur de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA), a annoncé des changements radicaux dans les politiques fédérales de lutte contre le changement climatique, notamment en assouplissant ou en éliminant 31 règles environnementales. Le but : récupérer une partie des USD 20 milliards de financement alloués par le gouvernement Biden à l’énergie et au transport propres par le biais du Fonds de réduction des gaz à effet de serre.
« Aujourd’hui est la journée de déréglementation la plus importante de l’histoire des Etats-Unis », a-t-il déclaré. « Nous plantons une dague dans le cœur de la religion du changement climatique, afin de réduire le coût de la vie pour les familles américaines, d’exploiter le plein potentiel de l’énergie américaine et de ramener les emplois automobiles sur le sol national, entre autres1. »
Cette décision intervient à la suite de l’annonce de l’intention des Etats-Unis de se retirer de l’Accord de Paris sur le climat, pour la deuxième fois (après un retrait controversé lors du premier mandat de Donald Trump, qui citait alors des « préoccupations économiques »)2. Lors d’un entretien en novembre 2024, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait anticipé cette décision en la comparant à une mutilation. « L’Accord de Paris peut survivre, tout comme une personne qui perd un organe ou une jambe peut survivre. Mais nous ne voulons pas d’un Accord de Paris mutilé3 », avait-il dit. Cette préoccupation est légitime, sachant que Washington contribue à hauteur de plus de 20% au budget opérationnel de l’Organisation, qui se chiffre à USD 100 milliards.
Depuis l’adoption de l’Accord de Paris, les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire ont connu une croissance exponentielle, et les investissements dans les énergies propres ont quasiment doublé par rapport à ceux consacrés aux combustibles fossiles
L’Accord de Paris, signé sous la houlette de Barack Obama en 2015, est un traité international historique dont l’objectif est de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C et de poursuivre les efforts pour le maintenir à 1,5 °C. Depuis son adoption, les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire ont connu une croissance exponentielle, et les investissements dans les énergies propres ont quasiment doublé par rapport à ceux consacrés aux combustibles fossiles4. Selon le rapport Energy Transition Investment Trends 2025 de BloombergNEF, les investissements dans la transition vers l’énergie sobre en carbone ont augmenté de 11% à l’échelle mondiale en 2024, atteignant le niveau record de USD 2’100 milliards. La part du lion est venue de la Chine, qui se positionne comme un leader des énergies renouvelables, compensant ainsi ses importantes émissions de gaz à effet de serre. En outre, si le pays dépend encore fortement du charbon pour répondre à sa demande croissante en énergie, il a réalisé des avancées considérables dans le développement de ses infrastructures et capacités manufacturières en énergie propre, investissant USD 818 milliards dans les énergies renouvelables en 2024, plus que les Etats-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni5.
La nouvelle stratégie énergétique de Donald Trump est centrée sur l’indépendance énergétique. Il place systématiquement la fracturation hydraulique au cœur de son programme de domination énergétique et a exhorté son gouvernement à accroître la production de combustibles fossiles, à moderniser les infrastructures et à revitaliser le secteur du charbon (qui affiche la plus forte intensité de carbone). Ses critiques affirment que cette mesure pourrait significativement entraver les progrès réalisés dans la lutte contre le changement climatique, d’autant plus que le charbon représente toujours plus d’un tiers de la production d’énergie mondiale et jusqu’à 40% des émissions mondiales de CO₂, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE)7.
Lire aussi : Comment Twelve boucle la boucle du carbone en convertissant les émissions en produits
Tout n’est pas perdu
Le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris et la réduction du financement des initiatives vertes pourraient nuire à la coopération internationale requise pour lutter contre la crise climatique à grande échelle. Toutefois, les décisions politiques n’enrayeront pas les moteurs économiques qui remodèlent déjà les initiatives mondiales en matière de durabilité. Elles ont plutôt redéfini les règles. Aujourd’hui, ce ne sont plus les politiques qui guident les décisions, mais l’économie, et ce, au gré des impératifs environnementaux et des opportunités économiques.
Plus des trois quarts des nouvelles capacités d’énergie renouvelable ajoutées en 2024 ont coûté moins cher que les combustibles fossiles
Nous en présentons les principaux moteurs ci-dessous.
Compétitivité
Les sources d’énergie renouvelable, telles que le solaire et l’éolien, sont de plus en plus rentables, faisant souvent concurrence aux combustibles fossiles grâce aux avancées technologiques et à une efficience accrue. Selon un rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), plus des trois quarts des nouvelles capacités d’énergie renouvelable ajoutées en 2024 ont coûté moins cher que les combustibles fossiles8. Cet avantage économique incite à poursuivre les investissements dans les infrastructures d’énergie propre.
Les besoins énergétiques croissants des technologies telles que l’IA alimentent la demande en sources d’énergie fiables et durables, favorisant ainsi la transition vers les énergies renouvelables
Innovation technologique
L’innovation est le fer de lance des initiatives mondiales en matière de durabilité, par le biais d’investissements significatifs, d’un bon engagement politique et des avancées technologiques. Les besoins énergétiques croissants des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) alimentent la demande en sources d’énergie fiables et durables, favorisant ainsi la transition vers les énergies renouvelables. L’AIE estime que la consommation d’électricité des centres de données d’IA va plus que doubler d’ici 2030. De plus, si l’IA fait peser de lourdes contraintes sur les systèmes énergétiques mondiaux, elle pourrait également favoriser le développement de nouvelles technologies susceptibles d’atténuer ces contraintes, telles que les véhicules autonomes ou la détection des risques pesant sur les infrastructures9.
De nombreuses entreprises s’orientent vers les énergies renouvelables, non seulement pour atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, mais aussi pour s’aligner sur l’évolution des attentes des consommateurs
Demande du marché
De nombreuses entreprises s’orientent vers les énergies renouvelables, non seulement pour atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, mais aussi pour s’aligner sur l’évolution des attentes des consommateurs et améliorer la réputation de leur marque. Les entreprises qui prennent la tête des initiatives de décarbonation devraient pouvoir saisir les opportunités qui émergent, reconnaissant qu’une innovation continue est nécessaire pour mettre au point des technologies durables plus rentables et évolutives. La demande en énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien devrait connaître une croissance régulière au cours des dix prochaines années10. Les combustibles fossiles (dont le charbon, le gaz naturel et le pétrole) représentaient environ 56% de la production mondiale d’électricité en 2024. Les sources d’énergie renouvelable (dont l’éolien, l’hydraulique et le solaire) ont quant à elles apporté 32% de l’électricité mondiale l’année dernière, contre 30% en 2023, selon un rapport du groupe de réflexion sur l’énergie Ember. Ces tendances devraient s’inscrire dans la durée. D’ici à 2035, les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire devraient représenter la majeure partie de l’approvisionnement mondial en électricité, les combustibles fossiles en fournissant seulement 31%11.
Les investisseurs reconnaissent la résilience et la valeur à long terme des investissements respectueux de l’environnement
Intérêt témoigné par les investisseurs
Les subventions publiques ont longtemps été déterminantes dans la réduction du coût des technologies d’énergie renouvelable, leur permettant de rivaliser avec l’industrie fortement subventionnée des énergies fossiles. Toutefois, les énergies renouvelables sont encore perçues comme favorables sur le plan environnemental et avantageuses sur le plan économique, ce qui continue à soutenir les investissements dans les énergies propres. La hausse des droits de douane pourrait poser des défis pour la chaîne d’approvisionnement en énergies renouvelables à court terme, sachant que de nombreuses composantes viennent d’Asie, mais les investisseurs reconnaissent la résilience et la valeur à long terme des investissements respectueux de l’environnement.
Si elle reste le premier pollueur mondial, la Chine est également le principal producteur mondial d’énergie renouvelable, occupant une position dominante dans le secteur des technologies propres
Le facteur Chine
La Chine accomplit des progrès considérables dans la transition vers l’énergie verte, grâce à des orientations politiques stratégiques, à un financement musclé et à des recherches fondées sur l’innovation. S'il reste le premier pollueur mondial, avec 32% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre en 202412, le pays est également le principal producteur mondial d’énergie renouvelable, occupant une position dominante dans le secteur des technologies propres13.
- Pékin a prévu de consacrer USD 800 milliards au cours des six prochaines années à la modernisation de ses infrastructures de réseau électrique, afin de répondre à l’expansion rapide des sources d’énergie renouvelable et d’atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici à 206014.
- La Chine reste en tête du marché mondial des véhicules électriques (VE). Les marques chinoises ont représenté 62% des ventes mondiales de VE en 2024, témoignant de la plus grande étendue de leur influence au-delà des frontières nationales15.
- Les entreprises chinoises se distinguent dans le domaine de la fabrication de technologies propres, produisant une part importante des panneaux solaires et éoliennes en service dans le monde.
- Le pays a déjà dépassé son objectif de capacité solaire et éolienne installée d’ici à 2030, avec six ans d’avance sur le calendrier16.
- La Chine fait désormais partie des leaders du déploiement des solutions énergétiques de la prochaine génération, notamment dans les domaines du stockage d’énergie à grande échelle et des technologies d’hydrogène propre.
Malgré les droits de douane élevés imposés par Donald Trump, les initiatives d’électrification stratégiques de la Chine ne montrent aucun signe de ralentissement. Déterminé à atteindre l’indépendance énergétique, le pays est rapidement en passe de devenir le premier « électro-état » au monde, l’électricité semblant destinée à devenir le vecteur énergétique dominant dans tous les secteurs. Cette stratégie s’inscrit dans le contexte de l’intensification des ambitions en matière d’IA de Pékin, exerçant une pression croissante sur une demande en électricité déjà importante. Plus tôt dans l’année, la Chine a attiré l’attention du monde entier, avec le lancement de DeepSeek, son modèle d’IA national, qui a souligné son influence croissante dans ce domaine, ainsi que l’importance stratégique que le pays accorde à son développement. Les besoins énergétiques accrus de l’IA sont à la fois un défi et une source d’opportunités. Les investissements s’accélèrent à mesure qu’un plus grand nombre d’entreprises se tournent vers le solaire, l’éolien et d’autres solutions d’énergie propre pour alimenter leurs centres de données de façon durable. Par ailleurs, la Chine redouble d’efforts pour consolider sa position de leader mondial de la transition vers l’énergie durable.
La transition vers une économie plus durable se poursuit, que Donald Trump la soutienne ou non, alimentée par des incitations convaincantes en matière d’économie, d’environnement et d’efficience
Quelles conséquences pour l’avenir de la durabilité ?
Les nouvelles politiques du gouvernement Trump, concernant notamment la hausse des droits de douane et les questions environnementales, laissent présager une COP 30 survoltée dans la ville amazonienne de Belém plus tard cette année. Elles influenceront très certainement la dynamique du sommet annuel des Nations Unies sur le climat, mais pour l’instant n’ont pas entravé la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. La transition vers une économie plus durable se poursuit, que Donald Trump la soutienne ou non, alimentée par des incitations convaincantes en matière d’économie, d’environnement et d’efficience.
Les motivations ne sont plus d’ordre politique et c’est au contraire le pragmatisme économique qui maintient la durabilité sur la bonne voie :
- l’innovation permet encore de répondre à la demande mondiale croissante en énergie ;
- l’énergie propre est maintenant moins chère que les combustibles fossiles dans une grande partie du monde ;
- les consommateurs exigent des actions respectueuses du climat, tandis que les investisseurs privilégient la responsabilisation ;
- les entreprises promeuvent la durabilité, non pas car elles y sont forcées, mais parce que cela est financièrement judicieux.
Donald Trump a réorienté le débat sur la transition climatique. Les environnements politiques seront très différents à l’avenir. Il ne fait aucun doute que la forme, le rythme et les jalons jugés importants changeront. La transition pourrait s’avérer plus chaotique que beaucoup ne le veulent. Mais nous sommes convaincus que la destination finale reste la même : une économie « net-zéro ». En effet, c’est le seul modèle viable sur le long terme, qui, en définitive, bénéficie de l’amélioration des fondamentaux économiques.







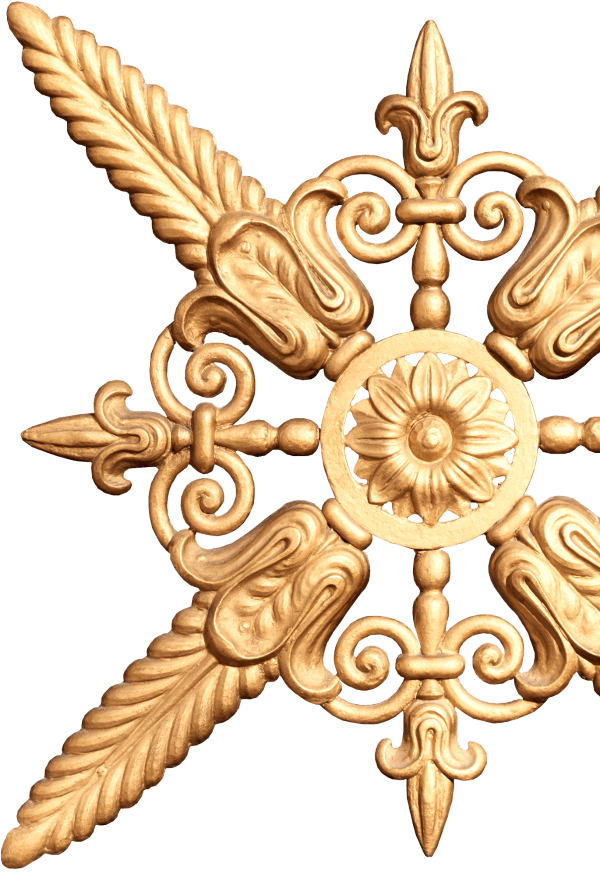
partager.